Billets
Sont entendus par "billets" les textes, bruts ou remaniés en "interviews", publiés sur des blogs scientifiques, sites d'institutions scientifiques ou plateformes de médiation scientifique avec comité de sélection ou de lecture.
Sont entendus par "billets" les textes, bruts ou remaniés en "interviews", publiés sur des blogs scientifiques, sites d'institutions scientifiques ou plateformes de médiation scientifique avec comité de sélection ou de lecture.

The Conversation, 11 février 2025
Alors que le Sommet pour l’action sur l’IA se poursuit à Paris les 10 et 11 février, les contours de l’IA restent flous. Dans ces conditions, comment développer une éthique applicable en pratique ?
Depuis la mise sur le marché de ChatGPT en novembre 2022, le discours politique, économique et médiatique est saturé de références à l’intelligence artificielle, dont il est devenu banal d’affirmer qu’elle doit être « responsable » et « éthique ». Volontiers décrite comme une révolution technologique inédite et une source infinie d’opportunités pour l’humanité par les uns, l’IA est en même temps décriée par les autres, tant ses impacts sociaux, énergétiques et économiques questionnent.
Je propose, dans ce flou discursif, de dégager trois piliers d’une éthique de l’IA simplifiée : l’intégrité, la dignité et la durabilité. Plutôt que de multiplier les lignes directrices complexes combinant parfois une dizaine de principes éthiques, pour certains peu opérationnels, un modèle à trois entrées paraît, en effet, aisément mobilisable.

Le Club des juristes, 6 février 2024
Le 26 janvier 2024, la plus haute juridiction des Nations unies a rendu une ordonnance en indication de mesures conservatoires dans l’affaire Afrique du Sud contre Israël de relative à l’application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza.

Le Club des juristes, 4 janvier 2024
Le gouvernement a finalement choisi de ne pas renouveler l’agrément de l’association Anticor. Une décision qu’elle va sans doute contester devant le juge administratif. Mais pourquoi l’association anticorruption a-t-elle perdu ce sésame qui lui permettait d’agir en justice en cas d’inaction du parquet ? Mystère. Où l’on comprend qu’il est urgent de réformer les modalités d’octroi de cet agrément.

Le Club des juristes, 1er décembre 2023
Le projet de loi sur l'immigration comprend une réforme controversée de la Cour nationale du droit d'asile, souvent négligée dans les débats axés sur l'immigration irrégulière.

Dalloz Actu Étudiant, 23 octobre 2023
Depuis plusieurs jours, le débat français fait rage autour de la qualification des horreurs perpétrées par la branche armée du Hamas en Israël le 7 octobre 2023. Cristallisé par la communication officielle du groupe parlementaire La France Insoumise, les positions se sont rapidement polarisées autour leur refus, de prime abord peu compréhensible, d’évoquer des actes « terroristes » au profit de la qualification de « crimes de guerre ».

Dalloz Actualité, 18 mars 2022
Le 16 mars 2022, la Cour a rendu son ordonnance en indication de mesures conservatoires dans l’affaire soumise par l’Ukraine le 26 février 2022. L’ordonnance exige que la Russie suspende immédiatement les opérations militaires débutées le 24 février 2022 sur le territoire de l’Ukraine et veille à ce qu’aucune unité militaire ou irrégulière sous le contrôle russe ne commette d’actes tendant à la poursuite de ces opérations militaires – y compris à la demande des deux régions du Donbass. Elle demande aussi aux deux parties de s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver, d’étendre ou de rendre le règlement du différend plus difficile.

Les Surligneurs, 3 mars 2022
Mercredi, l’Assemblée générale de l’ONU a, pour la première fois depuis 40 ans, contourné le Conseil de sécurité, paralysé par le véto russe, pour condamner fermement l’agression de l’Ukraine.
Mercredi 2 mars, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté, par 141 voix pour, 5 voix contre, et 35 abstentions, une résolution historique déplorant l’agression contre l’Ukraine et demandant à la Russie de mettre un terme immédiatement à son intervention armée. Une première pour l’ONU depuis 40 ans.
Les Surligneurs, 28 février 2022
Dimanche 27 février 2022, le président Ukrainien, Volodymyr Zelinsky, a annoncé avoir saisi la Cour internationale de justice contre la Russie. Cette annonce a été suivie, dans la soirée, par la confirmation par les services de la Cour dans un communiqué de presse puis la publication de la requête ukrainienne. Des audiences devraient se tenir rapidement au siège de la Cour à La Haye, où les représentants de l’Ukraine comme de la Russie seront invités à exposer leurs arguments.
Les Surligneurs, 26 février 2022
Juridiquement, les tentatives de justification par Vladimir Poutine de l’intervention en Ukraine ne tiennent pas, et il faut rappeler avec force les raisons qui font que cette agression est illégale.
La version du gouvernement russe est désormais bien connue : il s’agit d’une « opération spéciale » visant à « dénazifier » l’Ukraine et à protéger les populations des régions de Donetsk et Lougansk d’un prétendu génocide. Juridiquement, cette tentative de justification ne tient pas, et il faut rappeler avec force les raisons qui font que cette agression est illégale.
Le droit international contemporain, largement issu de la reconstruction post-1945 et du sentiment collectif que la paix entre les Nations devait être maintenue par le droit, repose sur un principe cardinal : la souveraineté des États. Et la souveraineté, c’est l’indépendance, c’est-à-dire pour l’essentiel la capacité de jouir librement de son territoire – sous réserve de ses obligations internationales librement consenties.
C’est sur cette souveraineté pleine et entière des États qu’est fondée la « colonne vertébrale » du droit international : l’interdiction du recours à la force entre États. Consacrée à l’article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations Unies signée à San Francisco en 1945, cette interdiction ne souffre que de trois exceptions. Aucune n’est invocable par la Russie en l’état actuel.
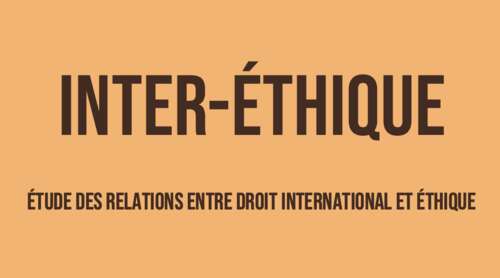
Blog Inter-Éthique, 22 décembre 2020
En ce mois de décembre 2020, la Cour internationale de justice, fort sollicitée par l’actualité contentieuse, a rendu publique sa « compilation des décisions […] concernant les activités extérieures de ses membres », annoncée quelques semaines plus tôt par le Président Yusuf lors de l’Assemblée générale des Nations Unies. Celle-ci entend réguler les activités extrajudiciaires des juges, dont certaines sont particulièrement lucratives et soulèvent des problématiques en termes d’indépendance et d’impartialité – ou d’apparence d’indépendance et d’impartialité. La principale d’entre elles est l’arbitrage, qu’il soit interétatique ou d’investissement, qui réunit fréquemment des juges en exercice. Leur sollicitation régulière n’a rien d’étonnant, dans la mesure où leurs compétences comme leur probité ne sont ni contestables, ni répandues. Ainsi, rien que dans le cadre de l’arbitrage CIRDI, au 21 décembre 2020, deux juges en exercice à la Cour étaient membres et/ou présidents de tribunaux constitués dans cinq affaires pendantes. Cette publication de la Cour était donc attendue, à la fois pour clarifier les règles déontologiques applicables aux juges et par mesure de transparence. Particulièrement discrète (I), elle laisse cependant apparaître de nombreux angles morts faisant douter de son utilité (II).
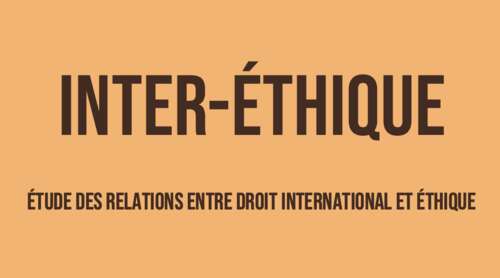
Blog Inter-Éthique, 16 décembre 2020
Le 5 novembre 2020, à l’occasion de la Journée internationale contre la violence et le harcèlement en milieu scolaire, y compris le cyber-harcèlement, une conférence internationale sur la lutte contre le harcèlement entre élèves était organisée. Selon le communiqué conjoint de l’UNESCO et du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, cette « conférence, qui s’appui[yait] sur les engagements pris lors de la réunion des ministres de l’éducation du G7 sous la présidence française en juillet 2019, vis[ait] à créer une dynamique mondiale pour mettre fin au harcèlement à l’école, en sensibilisant tous les acteurs, en partageant ce qui fonctionne et en mobilisant les gouvernements, les experts et la communauté éducative ».
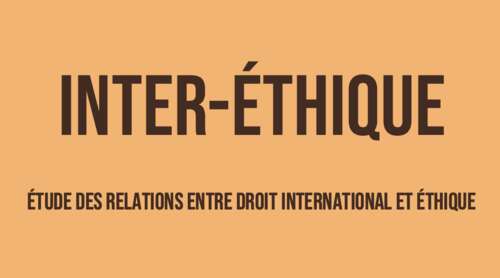
Blog Inter-Éthique, 19 octobre 2020
Le 4 août 2020, l’Organisation internationale du travail annonçait que « [l]es 187 États Membres de l’Organisation internationale du Travail (OIT) ont tous ratifié la Convention (n° 182) de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, 1999 ». Avec la ratification du Royaume des Tonga, la Convention 182 est dès lors devenue « la convention la plus rapidement ratifiée dans l’histoire de l’Organisation, depuis son adoption par la Conférence internationale du Travail il y a 21 ans ». « Résultat historique », « moment historique », « rappel puissant et opportun de l’importance des normes de l’OIT », la ratification universelle a été « saluée » de toutes parts.
Du point de vue du droit international, la ratification d’un traité est un acte unilatéral engageant l’État ratifiant à respecter son contenu. De point de vue éthique, cet acte est a priori neutre. Les États, comme les opinions publiques, peuvent en effet considérer que la ratification de tel traité va dans le sens d’une meilleure protection des droits humains, auquel cas la ratification pourra être perçue et présentée comme une action éthique – et son absence de ratification pourra le cas échéant être dénoncée et qualifiée d’omission non éthique par la société civile. À l’inverse, la ratification de tel traité facilitant le commerce de produits polluants ou dont la fabrication méconnaît notoirement certains principes éthiques – à l’instar du travail des enfants ou de la pollution des sols – pourra être considérée comme non éthique et dénoncée par la société civile, comme l’ont montré certains débats relatifs au CETA / AECG. En théorie, l’acte de ratifier un traité, de manière universelle ou non, n’est donc ni éthique ni non éthique : cette qualification ne peut être déterminée qu’in concreto, après examen de son objet, de son contenu et de ses conséquences.
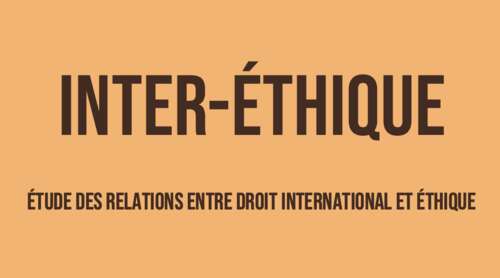
Blog Inter-Éthique, 28 septembre 2020
Dans une contribution publiée en 1997, le Professeur Christian Dominicé partait à la recherche de « principes d’éthique internationale » irrigant le droit international contemporain. Plus précisément, l’auteur recherchait les traces d’une « éthique des relations internationales » dans la jurisprudence de la Cour internationale de justice, y voyant une force créatrice du droit international : [...]
Sur la base de la réflexion initiée par l’auteur, il est intéressant d’interroger la manière dont l’éthique peut être identifiée en tant que source matérielle d’une norme proscrivant le recours à la force – la question des « principes élémentaires d’humanité » pouvant faire l’objet d’analyses ultérieures – (I), avant d’élargir plus brièvement le cadre de pensée aux difficultés soulevées par ce constat (II).
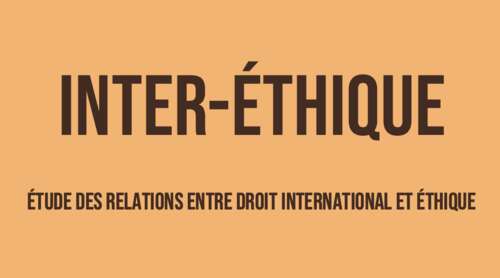
Blog Inter-Éthique, 21 septembre 2020
Le 1er mai 2020, le CIRDI et la CNUDCI annonçaient la publication d’un projet de Code de conduite pour les arbitres et autres personnes exerçant des fonctions d’adjudication : [...]
La publication de ce bref projet de Code de 12 articles, disponible en ligne, appelle plusieurs remarques. On peut rappeler brièvement son origine, qui montre une prise de conscience de la nécessité d’harmoniser les pratiques éthiques de l’arbitrage (I), avant de formuler quelques observations quant à son contenu (II).
Les Surligneurs, 25 janvier 2019
Le Traité d’Aix-la-Chapelle ne contient en réalité que peu d’engagements en matière de défense et de représentation diplomatique, mis-à-part une coopération accrue entre les deux États dans de nombreux domaines. Sur le plan diplomatique, il ne fait que formaliser une position franco-allemande connue depuis vingt ans, et grave dans le marbre le refus de la France de céder son siège de membre permanent du Conseil de sécurité. En matière de défense, il reprend des obligations d’assistance mutuelle déjà existantes et ne prévoit pas de partage de l’arme nucléaire.
Le 19 janvier 2019, Marine Le Pen, en déplacement dans le Vaucluse pour ouvrir la campagne de son parti pour les élections européennes, a abondamment critiqué le projet de Traité d’Aix-la-Chapelle, qui a été signé trois jours plus tard entre la France et l’Allemagne. Elle s’est notamment insurgée quant aux prétendues conséquences du Traité en matière de représentation diplomatique et de défense. En vérité, elle a essentiellement critiqué le Chapitre 2 du Traité, intitulé « Paix, sécurité et développement », laissant à l’eurodéputé Debout la France Bernard Monot le privilège d’agiter l’idée abracadabrantesque du rattachement de l’Alsace-Lorraine à l’Allemagne. Étant entendu que ce traité n’évoque à aucun moment l’Alsace-Lorraine, que dit-il exactement ?
Les Surligneurs, 17 avril 2018
Samedi 14 avril 2018, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis ont procédé à des frappes sur le sol syrien, visant des installations militaires et répondant à l’usage supposé d’armes chimiques par le régime syrien à Douma. Plusieurs États, à commencer par la Syrie, ont dénoncé ces frappes comme étant contraires au droit international. Et le droit leur donne raison.